 Page 1 - Page 2 - Page 3
Page 1 - Page 2 - Page 3
Il est nécessaire, pour comprendre la formation d'une chaîne de montagne telle que les Alpes, de s'intéresser à la tectonique des plaques (ex-"dérive des continents", les continents ne se déplaçant que portés par des plaques tectoniques de plus grande envergure). Très simplement, on peut dire qu'une chaîne de montagne peut avoir deux origines : la subduction d'une plaque océanique en dessous d'une autre plaque (exemple des Andes en Amérique du Sud) qui donne un arc volcanique, ou bien une collision entre deux continents qui se déplacent l'un vers l'autre (exemple de l'Himalaya et à une moindre échelle des Alpes).
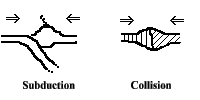
La lithosphère est la mince couche externe rigide du globe terrestre. La croûte terrestre (plus connue) ne représente que les 4/5 de cette lithosphère. La lithosphère est fragmentée en plusieurs morceaux (une vingtaine) de tailles très variables (depuis l'immense plaque Pacifique, jusqu'à de plus petites comme la plaque Caraïbes, et même de très petites, si minuscules que tous les spécialistes ne s'accordent pas sur l'intérêt de les classer en tant que plaques). Ces morceaux sont mobiles animés de mouvements relatifs et bien évidemment puisqu'ils couvrent toute la surface, il existe des affrontements à leurs frontières. Les relations entre deux plaques quelconques peuvent être un écartement (ouverture d'un océan et fabrication d'une lithosphère océanique), un rapprochement (subduction d'une lithosphère océanique sous une autre plaque ou collision) ou bien simple coulissement (avec bien sûr quelques secousses comme en Californie). Cette lithosphère rigide mais composée de plusieurs fragments mobiles "flotte" sur le manteau sous-jacent : elle a une densité plus faible que le manteau. Celui-ci n'est pas rigide : il est composé de roches solides mais possédant un comportement ductile sur une grande échelle de temps. C'est à dire qu'il flut par recristallisation des minéraux de ses roches. Il est animé de mouvements convectifs qui sont probablement à l'origine du déplacement des plaques lithosphériques de surface.
Il existe deux types de lithosphères : la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Chacune possède des caractéristiques géochimiques propres que je ne détaillerai pas ici. Il est simplement nécessaire de savoir que la densité de la lithosphère continentale est plus faible que celle de la lithosphère océanique. De façon simple on peut dire que cette lithosphère océanique est formée de roches basaltiques et gabbroiques (équivalent cristallisé du basalte), c'est à dire de roches sans silice alors que la lithosphère continentale est formée de roches de type granitique (présence de Si).
La faible densité de la lithosphère continentale ne lui permet pas de s'enfoncer dans le manteau. Elle ne peut jamais disparaître de la surface de la Terre alors que la densité de la lithosphère océanique atteind une valeur proche de celle du manteau lorsqu'elle est vieille et froide. En effet celle-ci est en constante évolution à la surface de la Terre, créée par volcanisme et détruite par subduction dans le manteau. Ce sont ces variations de la lithosphère océanique qui gouvernent la tectonique des plaques, d'où l'importance des océans (dans le sens espace océanique et non pas volume d'eau) dans l'évolution tectonique de la surface de la Terre.
 Page 1 - Page 2 - Page 3
Page 1 - Page 2 - Page 3
 Retour à la page sur la géologie.
Retour à la page sur la géologie.