 Page 2 - Page 3 - Page 4
Page 2 - Page 3 - Page 4
Aussi étrange que cela puisse paraître, la formation d'une chaîne de montagne n'est qu'une étape de l'évolution d'un océan.
En effet, pour fabriquer une chaîne de collision, il faut deux plaques continentales séparées qui se dirigent l'une vers l'autre et s'affrontent. Il faut donc tout d'abord qu'un océan s'ouvre pour séparer deux plaques continentales. Cet océan se crée par fabrication entre les deux continents d'une lithosphère océanique (distension). Puis cet océan finit par se refermer (la nature ne sait pas très bien ce qu'elle veut) par subduction d'une des plaques sous l'autre. Lorsque tout l'océan a été "consommé" il y a collision entre les deux continents car la lithosphère continentale à une densité trop faible pour s'enfoncer à la suite de la lithosphère océanique : elle "flotte". Un tel cycle (cassure d'un continent, ouverture d'un océan puis recollage des deux morceaux du continent) est appelé cycle orogénique.
Cette évolution peut être entièrement retrouvée dans les roches qui composent actuellement les Alpes, chaîne de collision qui évolue toujours (collision du continent Africain et de l'Eurasie).
La naissance d'un océan débute par une phase de rifting : étirement de la lithosphère continentale, cassure, affaissement de la zone médiane, création d'un bassin d'effondrement et apparition du volcanisme entre les deux parties. Ce bassin d'effondrement est marqué de part et d'autre part une série de blocs basculés qui permettent l'étirement crustal par le jeu de failles normales.
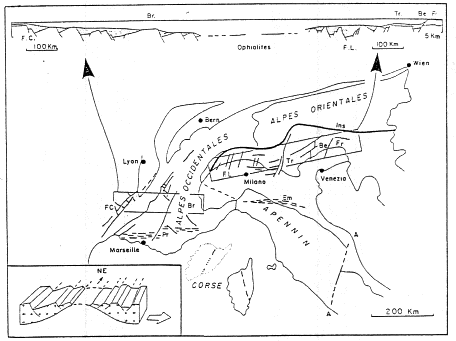
On trouve près de Bourg d'Oisans, à quelques kilomètres au sud de Grenoble, les traces du rifting Triasique qui a précédé l'ouverture de l'Océan Alpin. Les blocs basculés composants la marge européenne sont encore visibles malgré la collision alpine tertiaire qui a provoqué un rejeu inverse de toutes les anciennes failles normales (on parle d'inversion tectonique). Au niveau de la faille du Col d'Ornon on peut mettre en évidence un décalage de plus de mille (1000) mètres. Le décalage initial avant rejeu inverse était plus important mais aucun indice ne permet de donner une valeur. L'évolution du rifting est fossilisée dans les dépôts sédimentaires : on constate la présence de dépôts en éventail sur le sommet de chaque bloc, l'épaisseur de sédiments étant plus importante au creux du bloc que sur le sommet. De même l'âge de la dernière couche non soumise à ce phénomène (c'est à dire tranchée net par les failles normales) indique l'âge du début du rifting. Le rifting enregistré dans la marge européenne a commencé il y a 200 millions d'années et s'est terminé il y a 160 millions d'années.
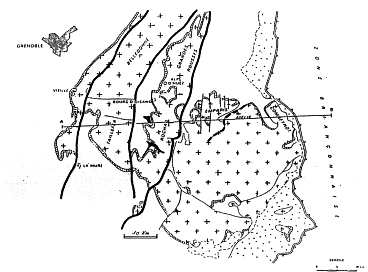
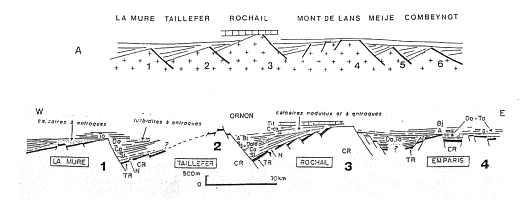
Lorsque la lithosphère continentale est suffisamment étirée il y a fabrication d'une lithosphère océanique qui vient combler le vide laissé par la séparation des deux parties du continent déchiré. Cette lithosphère océanique est créée par le volcanisme intense qui a lieu au niveau de la ride. L'origine de ce volcanisme est une fusion partielle des éléments du manteau sous-jacent. Cette fusion est due à la baisse de pression engendrée par l'étirement de la lithosphère (et donc à la diminution de son épaisseur). Les magmas issus de la fusion remontent (densité plus faible) vers la surface et provoquent le volcanisme.
C'est la phase d'expansion océanique, caractérisée par une ouverture rapide par rapport au rifting. Les deux moitiés du bassin d'effondrement se séparent progressivement par adjonction de lithosphère océanique à partir du milieu. Chacun des bords reste collé à son morceau de continent et forme la zone de transition entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. On appelle cela une marge passive.
Lors de la phase d'expansion océanique l'ouverture se fait au niveau de la ride médiane. Il n'y a plus de mouvements des blocs basculés des marges. Sur la marge européenne on enregistre un arrêt des basculements au début du Jurassique (présence d'une couche continue scellant toutes les failles). Il n'y a pas de marque tectonique de cette phase au niveau de la marge et on ne sait pas très précisément quand elle se termine. Seuls des indices extérieurs tels que les mouvements relatifs des continents peuvent permettre de comprendre l'évolution de l'Océan Alpin.
Le mouvement relatif des continents peut être connu par l'étude des fonds océaniques de l'Atlantique qui présentent des marques de variations de direction d'ouverture. On sait par exemple que la fermeture de l'Océan Alpin est due à un changement de direction dans le mouvement entre l'Europe et l'Afrique. Ce changement de direction se traduit par un phénomène assez commun dans l'évolution des océans : le saut de ride. En effet l'ouverture d'un océan ne se fait pas tout d'un coup d'un seul bloc du nord au sud de l'Atlantique par exemple. Il y a comme un effet de ciseau, la déchirure commençant en un point et progressant dans une direction pendant que, en arrière, l'ouverture se poursuit de plus en plus. Parfois la déchirure part dans une direction, l'ouverture commence, puis la déchirure s'arrête et repart dans une autre direction à partir d'un point situé en arrière.
C'est ce qui s'est produit pour l'atlantique : l'ouverture commençant dans l'Atlantique Nord d'aujourd'hui (entre Afrique de l'Ouest et Amérique du Nord), puis se poursuivant au Nord décalée plus à l'Est dans l'Océan Alpin (entre Europe et Afrique). Le mouvement entre l'Europe et l'Afrique s'est inversé au début du Crétacé il y a environ 80 ou 90 millions d'années, on ne sait pas exactement quand car cette époque manque d'inversions magnétiques (ce sont ces inversions qui permettent de marquer des tranches de même âge sur le fond des océans parallèlement à la ride médiane, et ainsi de mettre en évidence des variations de direction d'ouverture). Le mouvement d'ouverture de l'Océan Atlantique a repris en arrière à l'ouest de l'Europe et s'est dirigé plus vers le nord. La déchirure a même commencé entre le Canada et le Groenland avant d'avorter et de partir entre le Groenland et la Scandinavie. On voit ainsi que tour à tour L'Europe et le Groenland aurait pu se retrouver de l'autre côté du Grand Océan. A quoi tient l'histoire...Le témoignage de cette histoire mouvementé de l'Océan Atlantique (et donc de l'Océan Alpin qui lui est lié) ne peut être retrouvé dans la marge passive fossile conservée dans les Alpes du Nord, mais on peut en trouver les indices dans la disposition des sédiments sur le fond de l'Atlantique. Ceux-ci sont notamment mieux connus depuis que le programme de forage profond des océans a débuté il y a maintenant quelques dizaines d'années (Ocean drilling Programm). Il est également facile de comprendre le phénomène en regardant une simple mappemonde. On voit très bien le très large Atlantique du Nord, un palier au niveau Espagne - Terre Neuve, la branche avortée entre le Canada et le Groenland et la branche actuelle de largeur bien plus faible entre le Groenland et la Scandinavie. L'Atlantique Sud et Central se sont ouvert plus tard que l'Atlantique Nord (au Crétacé). Comme pour la partie nord de l'Atlantique, la déchirure a commencé au sud et s'est poursuivie vers le nord jusqu'à rejoindre l'Atlantique Nord (ouverture de l'Atlantique Sud d'abord puis de l'Atlantique Central).

Lorsque le mouvement relatif des deux continents séparés s'inverse (cela finit toujours par arriver un jour ou l'autre, les mouvements tectoniques de la croûte terrestre sont probablement liés à des mouvements convectifs dans le manteau, mouvements qui peuvent être variables), il y a convergence des deux plaques l'une vers l'autre. Ce sont des lithosphères océaniques denses composées de gabbros et basaltes : elles peuvent s'enfoncer dans le manteau sans difficulté. C'est une subduction. Il semblerait même qu'une plaque puisse s'enfoncer d'elle-même sans qu'il y ait de réelle convergence. Cela arriverait dans le cas d'une plaque océanique ancienne ayant eu beaucoup de temps (plus de 200 millions d'années) pour refroidir (augmentation de la densité). C'est pour cela qu'il n'existe pas à la surface de la Terre de lithosphère océanique de plus de 300 millions d'années : elles finissent toutes par disparaître dans des subductions.
Lors de la fermeture d'un océan les subductions peuvent s'inverser plusieurs fois dans le temps, se faire en plusieurs endroits différents simultanément ou même se faire dans un sens pour une partie de l'océan et dans l'autre sens pour l'autre partie.
Les zones de subduction sont caractérisées par une séismicité intense (plongée "en force" de la plaque subductée) et par un volcanisme intense (pas toujours). Lorsqu'une lithosphère océanique se subducte sous une autre plaque, elle introduit avec elle des sédiments marins hydratés dans le manteau. Cette présence d'eau (au sens chimique du terme : H2O) dans le manteau provoque une fusion partielle du manteau et un volcanisme en surface de la même manière que pour les rides mais en raison de causes différentes (H2O et non pas pression) et avec des conséquences différentes : dans le cas d'une extension il n'y a pas de croûte au niveau de l'étirement et le magma arrive directement en surface alors que dans le cas d'une subduction il doit traverser une croûte (océanique ou continental). Dans ce cas le magma est "pollué" chimiquement lors de la traversé et il en résulte par exemple des magmas chargés en silice (cas d'une croûte continentale). Ces magmas sont de ce fait très visqueux et les volcans de zones de subduction sont tous des volcans de type explosifs très dangereux pour l'homme (exemple du célèbre Krakatoa, du Mont Saint-Helens, du Pinatubo, et plus récemment du Mont Unzen au japon qui a coûté la vie à quelques géologues courageux dont Maurice et Katia Kraft).
Il existe des zones de subduction sans réel volcanisme : ces zones, peu nombreuses, sont liées à une inclinaison trop faible de la subduction. Il n'y a pas de réelle pénétration de la lithosphère dans le manteau.Il peut également y avoir création de bassin d'arrière-arc en arrière des subductions (exemple de la Mer du Japon). Ces extensions sont liées à un effet de succion : la plaque subductée plonge sous son propre poids, sans affrontement, et attire à elle la plaque d'en face, créant ainsi une extension en arrière de la subduction.
En ce qui concerne l'Océan Alpin on ne connaît pas exactement l'évolution dans le temps faute de témoins : tout a été engloutis dans la subduction. Au niveau de la marge, la phase de fermeture ne laisse pas de trace et il est impossible de connaître son évolution sans indices extérieurs. Cette phase de fermeture est assez rapide sous la montée vive de l'Afrique vers le nord.Tout ce que l'on peut observer au niveau de la marge est une subsidence régulière à partir de la fin du Jurassique (Malm). Cette subsidence régulière dure jusqu'au Sénonien où l'on observe les premiers signes de la collision alpine.
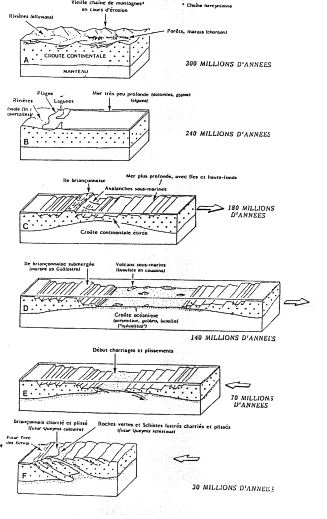
Figure : Marcel Lemoine et Pierre Tricart
 Page 2 - Page 3 - Page 4
Page 2 - Page 3 - Page 4
 Retour à la page sur la géologie.
Retour à la page sur la géologie.